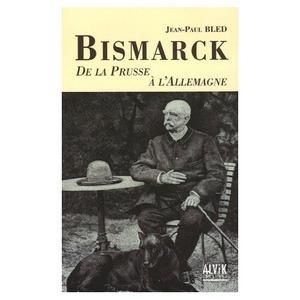Né en 1905 et élevé à Mannheim puis à Heidelberg, dans un milieu aisé et très convenable, Albert Speer se destina très tôt à la profession de son père, celle d'architecte. Parti s'installer à Berlin, il devint la victime, à la fin de ses études, de la crise qui s'abattit sur l'Allemagne. Dans une situation délicate, il ne laissa pourtant à l'époque percer aucun intérêt pour la politique et les deux mouvements radicaux qui s'opposent avec violence dans les rues de la capitale : le communisme et le national-socialisme. Jusqu'au jour de la fin 1930 où il accompagna des amis à un meeting d'Hitler. La fascination qu'il ressentit ce soir là pour le chef du NSDAP le poussa à s'inscrire au parti. Etant architecte et passablement désoeuvré, certains membres de la direction berlinoise - assumée à l'époque par Joesph Goebbels - firent appel à lui pour des travaux. Rien de suffisamment tangible pour justifier d'ailleurs sa future et soudaine ascension. Il faudra un concours de circonstance pour qu'il se distingue. Ce seront l'aménagement du bâtiment du Gau de Berlin (il y rencontra Goebbels), puis celle du ministère de la Propagande qui assureront sa notoriété dans les cercles dirigeants d'un NSDAP désormais au pouvoir. Le propagandiste boîteux le promut auprès de Hitler qui manifesta rapidement l'envie de le rencontrer. L'histoire était en marche. Cela n'empêchera pas Goebbels de devenir au fil du temps un des ennemis les plus acharnés de l'architecte devenu ministre.
La relation avec Hitler qui débuta en 1934 sera fondamentale pour Speer. Le chef de l'Allemagne nazie lui fit confiance. Se prenant lui-même pour un artiste, il apprécia le fait d'avoir auprès de lui quelque chose d'autre qu'un politicien, un combattant, quelqu'un ressemblant à ce qu'il auraot pu devenir sans l'engagement politique qui marqua sa vie. Du moins c'est ce qu'affirmait Hitler en ces années de grande proximité. Speer fit rapidement partie du premier cercle, sans jamais exercer de réelles fonctions politiques avant 1942. Durant ces années-là, il participa à plusieurs projets : la construction de la nouvelle chancellerie, la mise en chantier de la transformation de Berlin en Germania, monumentale capitale d'un Reich prévu pour durer mille ans, la conception et la réalisation des sons et lumières de Nüremberg, ces immenses et impressionnantes réunions nocturnes des nazis, etc... Hitler et Speer nouèrent une relation de proximité qui fit dire à certains que Speer était "l'amour contrarié d'Hitler". Il y eut toujours dans leurs relations une souplesse, une tolérance que le führer ne montrait avec personne d'autre. Fut-il resté favori du tyran et architecte, Speer ne justifierait pas que l'histoire s'y intéresse. Son héritage artistique est du reste extrêmement ténu, la plupart de ses projets ne virent jamais le jour et ceux qui le virent disparurent sous les bombes alliées. Son travail ne représentait d'ailleurs qu'une mise en oeuvre pratique des idéaux totalitaires : bâtiments massifs, grandiloquents, sans âme, au service de l'idéal totalitaire et de l'écrasement permanent de l'individu. Le chapitre sur Germania est d'ailleurs instructif à ce sujet. Le Dôme de 220 mètres de haut, l'arc de triomphe 50 fois plus volumineux que celui de la place de l'Etoile n'en sont que les plus célèbres avatars.
Lorsque la guerre débuta, le travail de Speer et ses projets architecturaux passèrent au second plan, même si Hitler n'y renonça jamais vraiment. Néanmoins, la destruction de quartiers entiers de Berlin, et notamment celui du quartier juif, furent le premier contact de Speer avec l'administration, la gestion et un rôle plus technocratique. Même s'il n'en parla à aucun moment dans ses livres - dissimulant même certains documents quant à cet évènement - Speer sut à l'époque que l'évacuation des juifs ne se passait pas sans violence. L'extermination des juifs n'était pas encore décidée. Mais le processus y menant était enclenché. Fest revient sur cet épisode et tente d'éclaircir le silence gêné que Speer laissa longtemps planer à ce sujet. Il en conclut que dès 1938, Speer savait déjà que la politique antijuive pratiquée avait développé des aspects inhumains et inacceptables. Mais que, comme une partie des allemands, sans états d'âme, il se voila la face.
 Speer
Speer Au début 1942, l'Allemagne est en guerre contre l'Union Soviétique et le Royaume-Uni. Ses succès initiaux ne lui ont pas permis d'emporter la partie face à Londres et à Moscou. Elle a de plus imprudemment ouvert les hostilités face aux géant américain au lendemain de Pearl Harbour. Alors qu'il était venu rencontrer Hitler dans son QG de l'est, en février, Speer vécut le tournant de son existence. Le Dr Todt, ministre de l'armement, se tua dans un étrange accident d'avion et Hitler décida de nommer son architecte à sa place. Propulsé à la tête d'un département qu'il ne connaissait pas, dans un environnement plutôt défavorable, il parvint en quelques semaines à augmenter la production de guerre. Durant toute l'année 1942, Speer lutta avec succès contre les incohérence de la pratique hitlérienne du pouvoir et parvint à diminuer peu à peu les ingérences des autres hiérarques dans son domaine. Il est utile ici de rappeler brièvement que l'Allemagne nazie ne fonctionnait pas de manière pyramidale. Bien au contraire, elle était un chaos organisé, dans lequel les missions avaient plusieurs titulaires et dans lequel les luttes de personnes, de clans, faisaient rage sous l'arbitrage suprême du führer. Être proche de lui, comme Speer pouvait l'être, c'était l'assurance d'être écouté et donc d'atteindre ses buts. Dans la lutte féroce que se livraient les membres du premier cercle, Speer fit longtemps très bonne figure. Fin 1943, certains semblaient même voir en lui un héritier possible de Hitler. Lui-même ne fut pas sans caresser cette idée, devenir Führer (témoignage de proches). Seulement les très bons résultats de son ministère, son ascension même, commencèrent à susciter des jalousies mais également à lui faire perdre quelque peu le sens de la mesure. Opposé de plus en plus farouchement aux représentants du Reich dans les régions, les gauleiters, tous vieux membres du Parti, il commença lentement à perdre pied et à tomber en disgrâce. En outre, les hiérarques, Goering, Bormann, Ley, Goebbels, Himmler commençaient à le considérer comme un rival potentiel et sérieux.
D'abord mesuré, le déclin de son influence s'accrut avec l'enchaînement de défaites que connut le Reich. Après deux ans de travail forcené, le physique même de Speer le lâcha. Malade au début 1944, il fut envoyé se faire soigner dans une clinique tenue par le médecin personnel de Himmler, le docteur Gebhardt (sinistre SS exécuté après guerre). En fait de soins, il fut victime d'une sorte de tentative d'assassinat médical lent qui n'échoua que par la détermination de Speer à fuir la clinique. Désormais Speer avait perdu la main. Il demeurait un ministre important, aux résultats convaincants, mais il était en conflit avec la plupart des principaux nazis. Cependant son statut d'ancien favori de Hitler le protégea finalement contre toute sérieuse tentative d'élimination. En juillet 1944, l'attentat contre Hitler mit en cause plusieurs militaires proches du ministre de l'armement. Non impliqué, il fut néanmoins soupçonné et perdit d'autant plus d'influence au sein du pouvoir. Lors de la lente agonie du IIIe Reich, la production d'armement devenant de plus en plus difficile - la chasse de la Luftwaffe n'empêchait plus guère les bombardiers alliés de détruire les sites de production- Speer passa son temps à colmater les brèches. Lorsque la défaite devint inéluctable, Hitler prit des mesures de destruction généralisée de tous les moyens de survie du peuple allemand après-guerre : canalisations, routes, production d'electricité, etc... Speer l'empêcha le plus possible en se réclamant d'arguments ahurissants de naïveté. En gros, il disait : "ne détruisez pas les installations, nous allons bientôt contre-attaquer grâce à nos armes secrètes, et quand nous reprendrons position ici, il faut que tout soit en état de marche". Evidemment, le ministre de l'armement ne pouvait pas croire à l'existence de ces armements secrets, vu sa position dans l'organigramme administratif nazi. Mais cela suffisait le plus souvent à empêcher d'inutiles destructions supplémentaires et à contrecarrer le suicide collectif ordonné par le Führer. On devine déjà toute l'importance que Speer accordera à cette sorte de résistance finale dans les épreuves futures.
Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. Quelques semaines durant, les diadoques encore en vie, dont Speer, "gouvernèrent" de Flensburg sous l'égide du successeur de Hitler, l'amiral Dönitz. Rapidement les alliés mirent fin à la mascarade et, dans la suite de l'année, décidèrent de juger les hiérarques survivants. Hitler, Himmler, Goebbels suicidés, Bormann disparu, il restait cependant suffisamment de dirigeants pour organiser un procès, le célèbre procès de Nuremberg. Alors que ses coaccusés tinrent une ligne de défense centrée sur leur irresponsabilité et sur leur obéissance aux ordres de Hitler, Speer fut le seul à reconnaître sa responsabilité et à remettre en cause la nature même de ses actes. Nul ne parvint jamais à savoir si c'était là une stratégie pour échapper à la potence, toujours est-il qu'il ne fut condamné qu'à vingt ans de prison. Le récit circonstancié de son maigre projet d'assassinat du Führer en 1945 eut un impact sans commune mesure avec l'importance réelle de cette tentative. Les historiens, avec les découvertes faites depuis, à propos des juifs de Berlin, de la visite d'usines et de camps de travail ou du travail forcé aux conditions proprement infernales, pensent que Speer aurait en fait du être exécuté comme dix autres hiérarques. Mais il s'en sortit, et Fest n'est pas le dernier à soupçonner Speer d'avoir su manipuler le procureur Jackson et l'accusation pour s'en sortir. Durant sa longue détention, l'ancien ministre de l'armement rédigea ses deux ouvrages les plus célèbres, sans guère de concession envers lui-même. Il y fit notamment son autocritique et cherche à comprendre les raisons qui le poussèrent à participer à une des plus criminelles entreprises de l'histoire. La fascination éprouvée à l'égard de Hitler, les opportunités de carrière que le nouveau régime lui offrit en sont probablement les causes principales. Il est d'ailleurs remarquable que Speer, réfléchissant des années après, révèla son incapacité totale à choisir, s'il devait revivre sa vie, entre une existence bourgeoise sans heurts et son destin dans la tragédie nazie. Et ce malgré tout ce qu'il en savait et ce qu'il comprenait de ses responsabilités. Libéré en 1966, il vécut une vieillesse relativement médiatique avant de s'éteindre en 1982.
 Joachim Fest (1926-2006)
Joachim Fest (1926-2006) Joachim Fest conclut cette biographie par un chapitre extrêmement pertinent sur Speer et ce qu'il représente. D'abord l'assujetissement à Hitler. Fest l'analyse non du point de vue de l'architecte, mais de celui de Hitler lui-même, qui montra un grand acharnement à séduire puis à garder celui qu'il voyait comme son égal artistique. Reprendre ici les arguments de l'historien dépasserait les limites de cette déjà longue note de lecture, mais on peut résumer l'idée centrale du lien Speer-Hitler en une fascination réciproque qui aveugla l'architecte sur la nature réelle de la personne qu'il avait en face. Deuxième point notable, Speer fut le seul à reconnaître sa propre culpabilité, sa responsabilité et à y réfléchir aussi longuement. Fest ne conteste pas la sincérité de cet aveu. Mais il lui attribue une cécité morale, une insensibilité, une froideur émotionnelle (souvent constatée par ceux qui connurent Speer), une capacité de refoulement qui explique que la reconnaissance de sa propre culpabilité ait pu toujours laisser une sorte de gêne à ceux qui le connurent. Il était sincère, mais au fond, ressentait-il réellement la portée de ses actes? Cette gêne mise à part, Fest reconnaît à Speer le mérite de n'avoir jamais mythifié le régime ou de s'être absous ses propres responsabilités. Reste ce vide émotionnel. Enfin, Fest voit chez Speer, homme talentueux sans être génial un trait rarement noté par ses biographes : le fait qu'il était incapable d'agir par lui-même. Il lui fallut une impulsion extérieure pour devenir architecte (son père), pour réaliser ses travaux des années 30 (Hitler), pour se plonger dans la politique de l'armement (Hitler encore) qu'il n'avait jamais ambitionnée, pour reconnaître sa culpabilité et écrire deux volumineux essais sans trop de concessions quant à son rôle historique (le procès de Nuremberg). L'idée de Fest, assez séduisante, c'est que Speer, sans convictions profondes, pragmatique, arriviste, ambitieux, sans sens moral, est plus proche de beaucoup d'entre nous qu'une bonne partie des désaxés qui gouvernèrent l'Allemagne durant douze ans. Produit de la civilisation des moeurs et des idées, il devint sans complexe et sans recul le complice d'une des plus odieuses barbaries de l'histoire. Et c'est peut-être cela qui rend Speer si moderne, si intéressant psychologiquement. Le conformisme ambitieux poussé à son paroxysme, jusqu'à l'absence de sens moral : une existence fonctionnelle, au rythme imparti par d'autres, une vie sans qualités.
Vous le devinez déjà, si j'ai consacré tant de lignes à ce livre, c'est que je le trouve extrêmement intéressant. Au niveau factuel, ayant déjà lu pas mal de livres au sujet du IIIe Reich et de Speer, je n'ai pas appris grand chose. Sinon quelques éléments sur les juifs de Berlin et sur le travail forcé. Ce que j'ai trouvé de plus enrichissant, c'est la lumière jetée sur les vides de la personnalité de Speer, sur cet étrange malaise ressenti à la lecture du Journal de Spandau ou d'Au coeur du Troisième Reich. Vous n'êtes pas devant quelqu'un qui défend un bilan, ou qui tente de s'absoudre - peut-être un peu, mais c'est bénin comparé à tous les autres -, non, il reconnaît sa culpabilité, celle de Hitler. Et pourtant, vous avez cette impression que ça ne suffit pas. Qu'il n'a pas tout compris. Que quelque chose manque. Ce ressenti, Fest l'éclaire dans un magistral dernier chapitre qui constitue, à mon sens, le point final de ce qui peut être dit sur le personnage, sauf nouvelle découverte improbable.
Un bémol seulement, pourquoi donc Perrin, l'éditeur, a-t-il jugé bon de sous-titrer le livre "Le confident de Hitler", un peu comme on publie, le porte-monnaie intéressé, les confessions d'un laquais de tel ou tel grand de ce monde? Ce n'est pas rendre service au livre. Speer n'était pas le confident de Hitler, qui n'eut sûrement jamais personne de ce type pour jouer ce rôle, mais bien le témoin le plus proche, le plus prolixe et le plus honnête intellectuellement qu'ait laissé l'atroce bal des criminels que fut le régime nazi... En outre, l'éditeur a poussé la malhonnêteté jusqu'à travestir le sens du livre sur la quatrième de couverture, qui sous-entend que l'ouvrage "prouve enfin qui était vraiment ce salopard". Ce qui n'est pas la teneur du livre, qui ne cherche pas à dénoncer mais bien à comprendre et à faire comprendre le trajet d'un homme normal jusqu'aux abysses du crime. Une lecture difficile à ignorer pour qui s'intéresse au sujet.




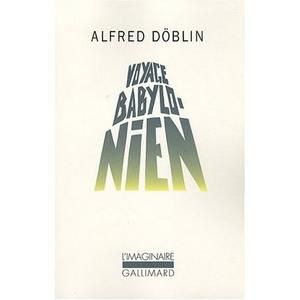
 Alfred Döblin
Alfred Döblin 
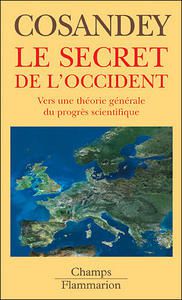

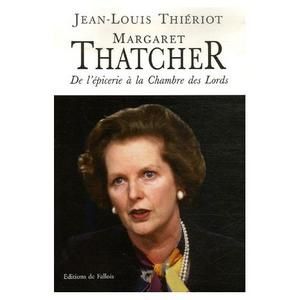
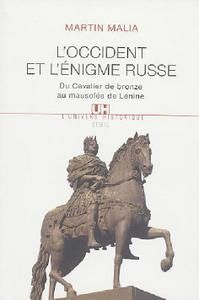
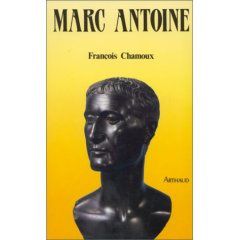

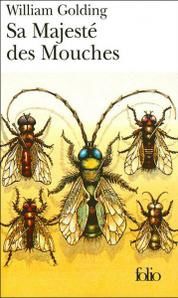
 Pougatchev
Pougatchev  Haïtien imitant Napoléon...
Haïtien imitant Napoléon...