La biographie est un art délicat. Et la biographie littéraire un art de l’impossible. L’exposé de la vie d’un dirigeant politique, d’un militaire ou d’un scientifique recèle déjà de multiples chausse-trappes : les sources, la qualité des témoignages, la subjectivité du regard biographique, ses buts,... Les biographes estiment généralement pouvoir échapper à l'hagiographie ou au portrait à charge, mais mon expérience de lecteur prouve que l’historien le plus expérimenté parvient rarement à s'en départir réellement. Et s’il évite ces écueils, le plus souvent il conclura son récit par un jugement moral ou historique. Le travail historique le mieux mené pourra aboutir à une position équilibrée sur le bilan et les caractéristiques de son « personnage ». Mais il sera difficile de trouver alors l’équilibre entre le récit de l’individu et celui de la collectivité dans laquelle il s’insère. La voie entre une contextualisation efficace et un hors-sujet partiel est si étroite qu’elle en devient impraticable. Il sera malaisé d’éviter le portrait psychologique tout en donnant une profondeur suffisante aux traits personnels du sujet. Bref, toute biographie est un échec. Et il n’est d’échec plus inévitable que d’essayer de retracer la vie d’un écrivain. Le chercheur doit alors composer son travail en conciliant la vie et l’œuvre – deux massifs qu’il faut aborder l’un par l’histoire, l’autre par les lettres – , l’existence publique et l’existence privée, les écrits publiés et les écrits reniés. Il se doit aussi d’explorer l’intégralité des correspondances, de déterminer la nature de chaque relation, de comprendre les motivations de l’écrivain et la réception de ses écrits, de démêler les contradictions, d’analyser les prises de position à la lumière de leur contexte et d’éclaircir la nécessaire part obscure que recèle tout individu. Sans un minimum d’honnêteté et de modestie, non seulement le biographe rate son but, mais finit par se mentir et par la même occasion, trompe le lecteur.

Cette modestie et cette pleine conscience de l’échec nécessaire du travail biographique ne doivent pas empêcher l’aspirant biographe de se lancer dans l’entreprise. Car l’échec ne signifie pas la faillite. Et du travail fourni pourront toujours surgir des faits, des idées et des conclusions justifiant l'énergie et l'ardeur déployées. Bernard Crick, récemment décédé, s’est de cette manière attaqué, une vie durant, à l’un des plus insondables écrivains du 20e siècle, George Orwell. La figure mythique du romancier anti-totalitaire de 1984, du satiriste génial de La ferme des animaux, a été déformée au fil de sa réception. La perception générale de l’écrivain, et surtout le sens de l’œuvre, ont été altérés. Bernard Crick, avec une honnêteté louable et une grande détermination, a tracé un portrait très intéressant d’Orwell.
Comme tous les biographes littéraires, il s’est trouvé confronté à plusieurs dilemmes, deux assez généraux et un plus lié à son sujet : la place qu’il convient de laisser à l’œuvre dans le récit de la vie, sachant que les deux sont étroitement imbriqués ; le moyen de traiter des zones d’ombre, de cette matière noire qui constitue une partie non négligeable de la vie d’un homme ; et concernant spécifiquement Orwell, le moyen de cerner un auteur qui mélangea fiction et récit autobiographique une bonne partie de sa carrière ; qui, pour tout journal ne tint que des comptes-rendus superficiels et prosaïques de son existence ; qui évita également de communiquer à ses proches de quelconques propos introspectifs.
Bernard Crick opte pour une position défendue avec soin dans son introduction, et qu’il tient avec une grande maîtrise tout au long de son travail. L’œuvre est un peu délaissée au profit de la vie, privée et publique. Au vu des positions du biographe, ce choix de restreindre la place de l’œuvre est compréhensible quoique regrettable pour le lecteur français. Le récit de vie doit éclairer une vie de récits. Ce n'est pas ici une exégèse de l'oeuvre. D'autant plus que le lecteur britannique, à qui s’adresse d’abord Crick, connaît bien mieux l’œuvre d’Orwell que le lecteur français. De ce côté de la Manche, les traductions manquent parfois et la diffusion s’avère, hors 1984 et Animal Farm insuffisante : une partie du lectorat francophone pourra être un peu déçu, car il lui manque une partie de l’œuvre. Le lecteur peu au fait de la vie intellectuelle anglaise des années 30 et 40 regrettera à certains moments que l’auteur de cette somme ne se rende pas plus accessible. Mais le public anglophone cultivé n’a pas les mêmes lacunes culturelles : EM. Forster, TS. Eliot, Christopher Isherwood, Kypling, Maugham sont des références aussi connues par le public anglais que Gide, Camus, Aron et Mauriac le sont pour le public français.
Avec une certaine honnêteté, Crick renonce à prendre position lorsque les sources manquent, ou lorsqu’elles entrent en contradiction. Attaché aux faits, optique finalement assez britannique, toute prosaïque et pragmatique, Crick ne cherche pas à remplir les trous par ses propres prises de position, ou par d'audacieuses généralisations théoriques. Par contre, il montre une grande ardeur à trouver la matière permettant de combler ces lacunes. Et si cette recherche intensive ne livre pas d’éléments probants, alors il l’admet et le dit. Cette approche est poussée à un tel degré que cette seconde édition ne modifie pas, sauf erreur de frappe, la première édition, elle la complète et la corrige par des astérisques et un appendice. Crick pointe donc ses propres erreurs et imprécisions avec une transparence méritoire. Et comme le sujet Orwell était bien peu prolixe au sujet de ses turpitudes, tout un espace, celui de la vie intérieure d’Orwell, reste vide. Le portrait qu’en dresse Crick tient plus du contour que de l’étude. Mais à aucun moment il ne bascule dans l’esquisse. Tout ce qui peut être détaillé l’est. Cela donne à son livre un aspect aride et moins vivant qu’il aurait pu l’être. On lui reprocha d'ailleurs d’en rester à la surface, aux faits.

Sir Bernard Crick, décédé le 19 décembre dernier
Mais Crick demeure bien dans la droite ligne d’Orwell, de la décence, du common sense et de l’honnêteté intellectuelle : les faits plus que la théorie. L’intériorité d’Orwell reste un territoire inatteignable sans imagination et psychologisme. Et ces deux traits qualifient un travail romanesque, non un travail historique. Le lecteur reste donc en partie extérieur à l'homme Orwell. Le livre pourrait en perdre de l’intérêt, mais bien au contraire, il stimule l'intelligence du lecteur qui interprétera comme il l’estime juste les éléments portés à sa connaissance. Pour Crick, la vie ce sont les actes, et sans témoignage probant, prendre position est malhonnête. Crick est l’exigeant lecteur des témoignages de chacun et il ne conclut qu’une fois toutes les possibilités pesées, et quand il le faut, écartées. Son examen est critique : sa posture de composition n’ignore ni les défauts d’Orwell, ni ses incohérences et encore moins ses erreurs. Et quand il essaie de déterminer autant que possible la part d’autobiographie dans les romans ou les récits d’Orwell, son argumentation, détaillée, circonspecte, emporte largement l’approbation du lecteur. Ce travail magistral, malgré son désintérêt partiel pour l’œuvre, est une véritable référence dans le domaine de la biographie littéraire. Il a échoué parce que le portrait total d’un écrivain est irréalisable. Sartre lui-même l'avait expérimenté à ses dépens avec Flaubert. L'échec de Bernard Crick est glorieux, car il trace une voie stimulante dans la compréhension d’Orwell, de ce qu’il fut, de ce qu’il représenta et de ce qu’il affirma. Au lecteur averti et informé de trancher.

George Orwell, né Eric Blair, issu des échelons inférieurs de la classe moyenne anglaise du début du siècle dernier, a connu une vie courte mais aventureuse. Issu d’Eton, antichambre de l’élite politique, administrative et culturelle anglaise, il emprunta dès sa sortie des chemins de traverse. Policier en Birmanie, marginal à son retour en Europe, combattant de la guerre d’Espagne peu à peu retranché dans des positions socialistes ET anticommunistes, contempteur de l’esprit de parti et de l’aveuglement de la classe intellectuelle, il est un type quasi sui generis d’écrivain. Principalement porté sur l’écriture politique, son œuvre rentre difficilement dans les grandes catégories de la partition romanesque : autofiction bien avant la lettre, satire, dystopie,…
Comme certains de ses contemporains, Crick le place au côté de Swift dans la grande tradition de la critique politique de langue anglaise. Mais il ne s’arrête pas à ce simple constat, et le resitue aussi dans son environnement intellectuel immédiat, composé de socialistes anticommunistes, d’anarchistes et de progressistes. Crick privilégie l’aspect politique, central dans l’œuvre. Orwell se révéla à ce sujet souvent clairvoyant et visionnaire. Mais Crick ne passe pas sous silence ses prophéties hasardeuses du début des années 40. Avec succès, il démontre à quel point la lecture de 1984 et de La ferme des animaux ne peut se limiter à l’approche simplement anticommuniste à laquelle certains tentèrent de le confiner. Ces romans ne parlent pas seulement du soviétisme, même s'ils se révélèrent pertinents pour décrire l'URSS. Ils abordent aussi le thème de la trahison des élites intellectuelles (les cochons de la ferme) et celui de l’écrasement des valeurs simples de l’homme commun par la mise en place de mécanismes totalitaires. Mécanismes dont ne sont pas exempts nos société démocratiques contemporaines. Crick parvient, par des références aux essais et aux prises de position d’Orwell, à en enrichir la lecture. La connaissance de l’homme, de ses choix, de ses actes, de son comportement sont éclairants. Orwell est rendu plus humain : son immense lucidité en un temps d’aveuglement intellectuel généralisé n’en est que plus estimable. Et cette biographie appelle le lecteur à se plonger sans réticence dans la pensée d’un des écrivains les plus marquants de notre passé proche.




On ne lit plus guère Péguy de nos jours. Son nom se perd dans les brumes d'ignorance qui ont recouvert les oeuvres de la plupart des grands écrivains de la période 1880-1914. Au plus, lorsqu'il est évoqué, parlera-t-on de Dreyfus, de Jaurès, de Jeanne d'Arc et de la Grande Guerre. Cette biographie bien documentée illustre fort bien d'ailleurs le gouffre qui sépare le normalien d'origine paysanne, à la prose mystique, de notre époque matérialiste et technicienne. En creux se dessinent les raisons d'une telle désaffection. Hors de l'Université - où Péguy est resté un sujet commode de recherche et d'analyse - que pourraient bien trouver les lecteurs d'aujourd'hui dans l'intransigeance et le mysticisme d'un mécontemporain de la Belle Epoque ? Et comme hier, à l'heure de la vénération satisfaite de notre civilisation et de notre ignorance, Péguy semble ne devoir toucher qu'une infime partie du public cultivé.
L'oeuvre de Péguy, dense et profonde ne se laisse pas, d'ailleurs, apprivoiser au premier regard. Et il faut bien du talent , ou de l'inconscience, pour vouloir évoquer l'auteur de l'argent, sa vie, son oeuvre, son influence dans un même ouvrage.
Arnaud Teyssier parvient à remettre en perspective l'itinéraire de Péguy : des derniers jours de la république opportuniste à l'Union sacrée, en passant par son engagement majeur, l'innocence de Dreyfus, il retrace les écrits, les amitiés et les positions de l'écrivain, d'abord socialiste puis converti peu à peu à un christianisme mystique et personnel. Il s'agit là de rendre intelligible l'itinéraire avant tout solitaire de ce franc-tireur.
Teyssier retrace son refus du système, du professorat, des compromissions et des honneurs, la lutte quotidienne pour la survie de son entreprise indépendante (les cahiers de la quinzaine), loin de la société mondaine et des succès faciles (ceux d'Anatole France notamment), loin aussi des armées normalienne et socialiste auquel il fût d'abord tenté d'appartenir. Ostracisé par Lucien Herr, le bibliothécaire de l'Ecole Normale, écarté par Jaurès, reclus dans son refus implacable de se soumettre à l'enrégimentement intellectuel, Péguy ne connaîtra guère le succès sa vie durant. Il faudra sa mort héroïque, la veille de l'offensive de la Marne, d'une balle allemande, pour qu'il devienne, par Barrès interposé, l'icône de la République et de la Nation.
Difficile d'accès, traversée par une recherche sans compromission de la vérité autour de quelques figures tutélaires (Jeanne d'Arc et le Christ sur le versant mystique, Richelieu et Robespierre sur le versant historique), l'œuvre de Péguy aurait cependant mérité des développements plus longs. Teyssier semble en effet vouloir contourner l'écueil que forment les textes de l'écrivain, en ne les abordant que trop superficiellement. Cette biographie, un peu courte, évacue aussi l'impact de l'écrivain sur le XXe siècle par une trop rapide conclusion. A la décharge de l'auteur du livre, Péguy reste difficilement accessible à l'historien, Teyssier le reconnaît lui-même, du fait de l'immensité de ses écrits et de la somme produite par ses exégètes. La modestie du projet éditorial (300 pages) et l'ampleur des éléments de contexte à livrer limitent considérablement les développements de fond et ont malheureusement contraint Teyssier à une approche très synthétique.
Ainsi, par souci pédagogique, il résume avec soin le contexte historique (opportunisme, boulangisme, affaire Dreyfus, socialisme, Barrès et Maurras, antagonisme franco-allemand), quitte parfois à oublier un peu son propre sujet. Après la lecture, il reste un étrange sentiment : la vie de Péguy est mieux connue, mais l'œuvre elle-même reste mystérieuse et incertaine.
Cependant, au vu de sa taille et de son ambition, ce livre constitue une introduction satisfaisante à Charles Péguy, dont les écrits, hors édition Pléiade, restent au demeurant difficilement accessibles.
Mes lecteurs l'auront remarqué, je n'ai plus guère trouvé le temps de mettre à jour ce blog depuis quelques mois. Mes lectures s'accumulent (mes achats également, pour le plus grand malheur de mon portefeuille et le plus grand bonheur de la librairie locale) et je me rends compte que la formule choisie à la base n'était pas la bonne. Elle aurait nécessité plus d'investissement pour un résultat à peu près valable.
Plutôt que de rédiger des fiches de lecture, rares, longues à composer, nécessitant un minimum de recherche et de concentration, oscillant entre critique et résumé, je vais plutôt me couler dans un format plus en rapport avec mes capacités. Le propos sera plus resserré, plus critique également. Et si certains livres me paraissent le justifier, ils seront l'objet d'articles plus longs, dans la veine de ce que j'ai produit depuis maintenant plus de deux ans (au final très peu de choses)
L'an dernier, lors de la recension d'Europa de Romain Gary, j'avais promis déjà un format plus court, je vais donc tenter (une dernière fois) de m'y tenir.

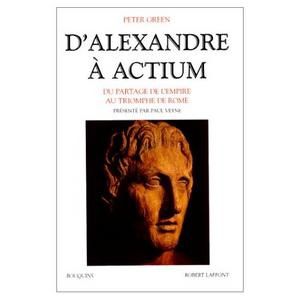
 Emergence d'une monumentalité inhumaine, ici à Pergame
Emergence d'une monumentalité inhumaine, ici à Pergame
 Rudolf Hess
Rudolf Hess 

 Une autre lecture, une vision plus radicale de l'homme, qualifié de malade mental, d'idéaliste pitoyable, de menteur instable et de dévot aliéné
Une autre lecture, une vision plus radicale de l'homme, qualifié de malade mental, d'idéaliste pitoyable, de menteur instable et de dévot aliéné 
 Steinbeck
Steinbeck